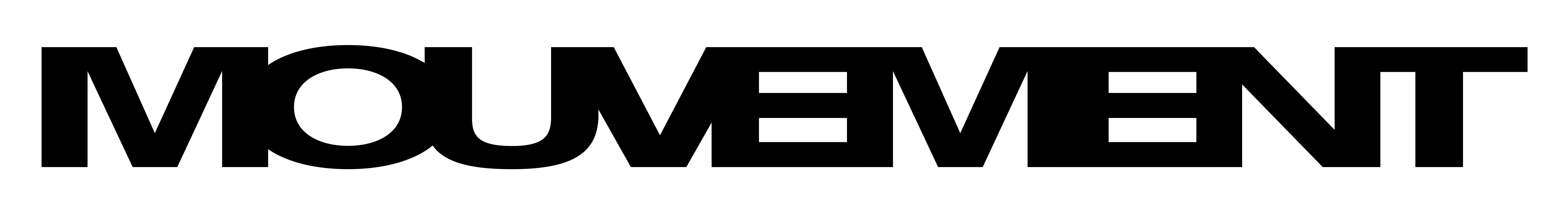Une chronique extraite du N°125 de Mouvement
1. La mala est gang.
Alors ? On est pas bien là ? « La mala est gangx », la fête est géniale, comme chantait Gazo dans l’un des tubes de 2021 – une époque pas si lointaine où on a désormais l’impression d’avoir baigné dans l’insouciance, maintenant qu’on ose à peine écouter les news de peur de ce qui va nous tomber dessus. Ah, on enlève 150 millions au budget de la Culture ? Allez. Ah, on arrête aussi le droit du sol ? Oki. Ah, on doit maintenant faire des heures de travail gratuit quand on est pauvre ? Super. Oh attends, pause météo, tu préfères sécheresse ou cyclone, toi ? Non, non choisis, je t’en prie, chacun son tour. Ça marche, on se fait un point rapide enfants noyés dans la Manche ou la Méditerranée, et on passe au LBD intelligent. Pas à dire : on s’éclate à en crever.
2. Le système le plus gang au monde.
Comme chacun sait, la démocratie est le meilleur système politique du monde. Elle permet à chacun d’être représenté, et de donner sa confiance à quelqu’un qui en fera bon usage. Inventée dans le temps épique des Grecs, elle doit nous servir à tous et toutes de guide car elle garantit sans aucun doute le progrès collectif et la sauvegarde des équilibres communs. La démocratie repose sur l’égalité des citoyens devant la loi, la séparation des pouvoirs, le respect des libertés individuelles et collectives. Bref : sous la démocratie, le régime protège le peuple et le peuple choisit le régime.
Et comme elle est le système le plus gang de tous, tout le monde en veut : on peut voir sur Wikipédia une carte mondiale des gouvernements se réclamant de la démocratie. Incroyable, pour une fois, tout le monde est d’accord. Le planisphère n’a plus aucune frontière, d’un beau bleu électrique, de la Russie démocratique à l’Angola démocratique, de la France démocratique aux États-Unis démocratiques. Tout le monde est démocrate. Moi aussi. Je précise, pour ne pas me faire taxer de mauvais esprit.
3. Millions envolés.
Mais alors c’est marrant, la démocratie mène chaque jour un peu plus à des choses que personne n’a l’impression d’avoir voulues ni souhaitées. Je ne crois pas que quiconque ayant voté à n’importe quel tour pour le gouvernement en place dans notre pays, ait voté pour des LBD intelligents. À la rigueur, on aurait plutôt eu envie de voter pour une police intelligente, mais personne ne nous l’a proposé : vous avez déjà entendu quelqu’un nous consulter avant de réduire les heures de formation des forces de l’ordre, comme c’est le cas depuis deux décennies ? Autant qu’on sache, il ne semble pas non plus que notre pays bleu démocratie, ou l’Europe de la même couleur, nous aient fait voter pour que des gens se noient dans la mer en plein hiver.
Pour en revenir aux coupes drastiques dans le budget de la Culture, même si le sujet semble dérisoire par rapport au reste, elles n’étaient au programme d’aucun des partis élus par les Français. Aucun. Ni le Rassemblement National, ni le Nouveau Front populaire, ni même le parti gouvernemental. Dans le système d’élection démocratique qui est le nôtre, nous avons donc tous et toutes voté autre chose que ces 150 millions envolés. Mais bon, on commence à avoir capté l’astuce : quel que soit le bulletin qu’on met dans l’urne, à la fin, on a : Élisabeth Borne, Manuel Valls, François Bayrou, des décrets, des coupes, des suspensions de dispositifs, enfin le pire des gangs du système le plus gang de la terre.
4. Antiphrase hyperbolique.
Dire « c’est gang », c’est comme dire « c’est une tuerie » : c’est inverser la valeur associée au sens premier et garder le sens hyperbolique. Donc « c’est gang », ça signifie « c’est stylé », là où un gang n’est pas, en soi, quelque chose de stylé, mais un regroupement de gens se mettant au-dessus des lois pour leur profit personnel, en utilisant la force et la peur. Les plus anciens exemples se trouvent dans l’Angleterre du XVIIe siècle, avec le racket et l’extorsion comme activités premières. Ce sont cependant les États-Unis qui ont fait des gangs une figure à part entière de la vie collective : dans les grandes villes, comme Chicago ou New York, les gangs se développent dès le début du XIXe siècle et font florès au XXe, avec pour activités la contrebande, le vol, et toujours, l’extorsion. La raison d’être initiale du gang, c’est de détourner des richesses collectives vers les membres du gang.
5. Une mafia qui a réussi.
Comme tout système mafieux, le gang partage une grande affinité avec l’État, au point qu’on a pu dire, à la suite du sociologue Charles Tilly, que l’État était une mafia ayant réussi – une mafia légitime. En effet, on peut considérer que la levée de l’impôt en échange de la protection des imposables est une forme de racket : si tu ne payes pas ton impôt, tu n’es pas protégé·e . Contre qui ? Contre nous, pour commencer : « Si le racket en échange de protection représente la forme la plus manifeste du crime organisé, alors l’État – quintessence de ce type de racket avec l’avantage de la légitimité – apparaît comme le plus grand exemple du crime organisé », affirme d’entrée de jeu son article le plus célèbre, « La guerre et la construction de l’État en tant que crime organisé » (2000). L’un de ses confrères, Barrington Moore, dans Les Origines sociales de la dictature et de la démocratie (1966), expliquait déjà à sa suite que « la féodalité européenne était principalement un gangstérisme devenu société elle-même, et ayant acquis une respectabilité grâce aux notions de chevalerie ». C’est-à-dire que les gens portant l’épée, après avoir acquis leur richesse en menaçant les plus faibles, se sont progressivement éduqués et moralisés au contact des vertus chevaleresques, telles qu’inventées et glorifiées dans les romans de chevalerie.
Les gangs plus récents, eux aussi, ont été adoucis par le biais de la narration : les films de Scorsese ou Coppola dépeignent les gangsters comme des hommes certes violents, mais répondant à une sorte de code d’honneur placé au-dessus des intérêts financiers. Ainsi le gang, à travers les siècles, devient une forme narrative épique : splendeurs et misères des affranchis, qui finissent, généralement, par se faire tuer par leurs pairs, ou attraper par la police – l’État, donc, qui les ramène de gré (programme de protection des témoins) ou de force (prison) dans son giron, celui du droit.
6. Devenir-gang.
Or, on dirait bien que le problème auquel on doit faire face aujourd’hui est une nouvelle formule de la même équation : après le gang devenu État, puis le gang domestiqué par l’État, nous voici face à l’État devenant gang. Vingt-six des ministres macronistes, selon le dernier décompte, ont affaire à la justice. Rachida Dati, ministre de la Culture, après avoir tenté par tous les recours possibles d’échapper à un procès, va comparaître cette année pour corruption et prise illégale d’intérêt. Le Premier ministre actuel, François Bayrou, reste soupçonné d’avoir organisé pendant des années un système d’assistants parlementaires fictifs au sein de son parti. On ne va pas dresser ici un inventaire, mais de code moral et de vertu chevaleresque, point.
Donc, pour résumer, nous votons, grâce à la démocratie, pour des gens qui détournent l’argent à leur profit, puis imposent l’austérité à la nation – par décret, puisqu’il est évident que nul ne l’a appelé de ses suffrages. Nous en sommes là : le budget de l’État a finalement été adopté par la grâce de l’article 49 alinéa 3 de notre Constitution, qui permet au gouvernement de se mettre au-dessus de la loi du suffrage universel. Qu’y a-t-il, dans ce nouveau budget ? C’est simple : tout diminue, l’hôpital, l’éducation, la culture, l’écologie, les dépenses des collectivités locales – tout, sauf l’armée et l’intérieur. Les militaires et les policiers. Les gens avec des armes plus ou moins intelligentes. Les élus deviennent gangsters, puis les gangsters s’arment.
7. La peur ou la vie.
Contre qui s’arment ces gangsters ? Pas contre l’État, puisque dans le cas présent, l’État est le gang. Donc, les gangsters s’arment contre leurs victimes. Pour que le racket fonctionne, il faut un ingrédient de taille : la peur. Vous ajoutez un Retailleau, un Darmanin, un Attal, pour faire des propositions de lois bien flippantes (contre les étrangers, les mineurs, les immigrés) ; vous laissez prospérer l’idée (« submersion », « intérêts de la nation ») selon laquelle la protection des bons citoyens, ceux qui obéissent et se laissent faire les poches, est nécessaire, non contre les gangsters, mais contre le faible, le pauvre et le différent. Vous prenez tant de mesures de surveillance et de pénalisation (généralisation de la surveillance algorithmique, armement des équipes de sûreté ferroviaire, etc.) que chacun se sent toujours légèrement inquiet. Et voilà, vous avez un système de racket parfaitement opératoire. Tellement gang.
Comment Charles Tilly explique-t-il que contrairement à une mafia, l’État ait permis, dans l’histoire, d’accéder à des formes de démocratie ? Par le comportement des sujets vis-à-vis de la guerre, fin et moyen des mafias et des États : « Quand des gens ordinaires résistaient vigoureusement [à la guerre], explique le sociologue en remontant les siècles, les autorités faisaient des concessions : garanties des droits, institutions représentatives, cours d’appel. » C’est donc dans la résistance de ceux qui subissent la « protection » du gang que se trouve la possibilité de sortir de la course à la guerre dont l’État, comme n’importe quelle mafia, tire son principal moteur. Dans notre système démocratique so gang, seul notre refus de participer peut faire baisser les armes. Notre refus d’obéir, donc. À chacun de savoir à quoi il ou elle obéit aveuglément, et comment il ou elle pourrait arrêter. Sur ce grand planisphère qui recouvre d’une même couleur bleue démocrate Milei, Netanyahou, Trump, Macron et quelques autres gangsters, il semblerait que nous n’ayons plus tellement d’options.
Désobéir à la peur qui fonde la possibilité du racket : ça, ce serait vraiment gang.
Lire aussi
-
Chargement...