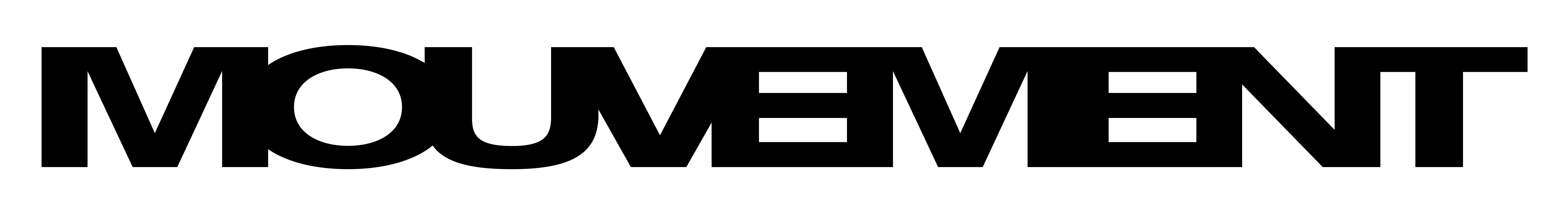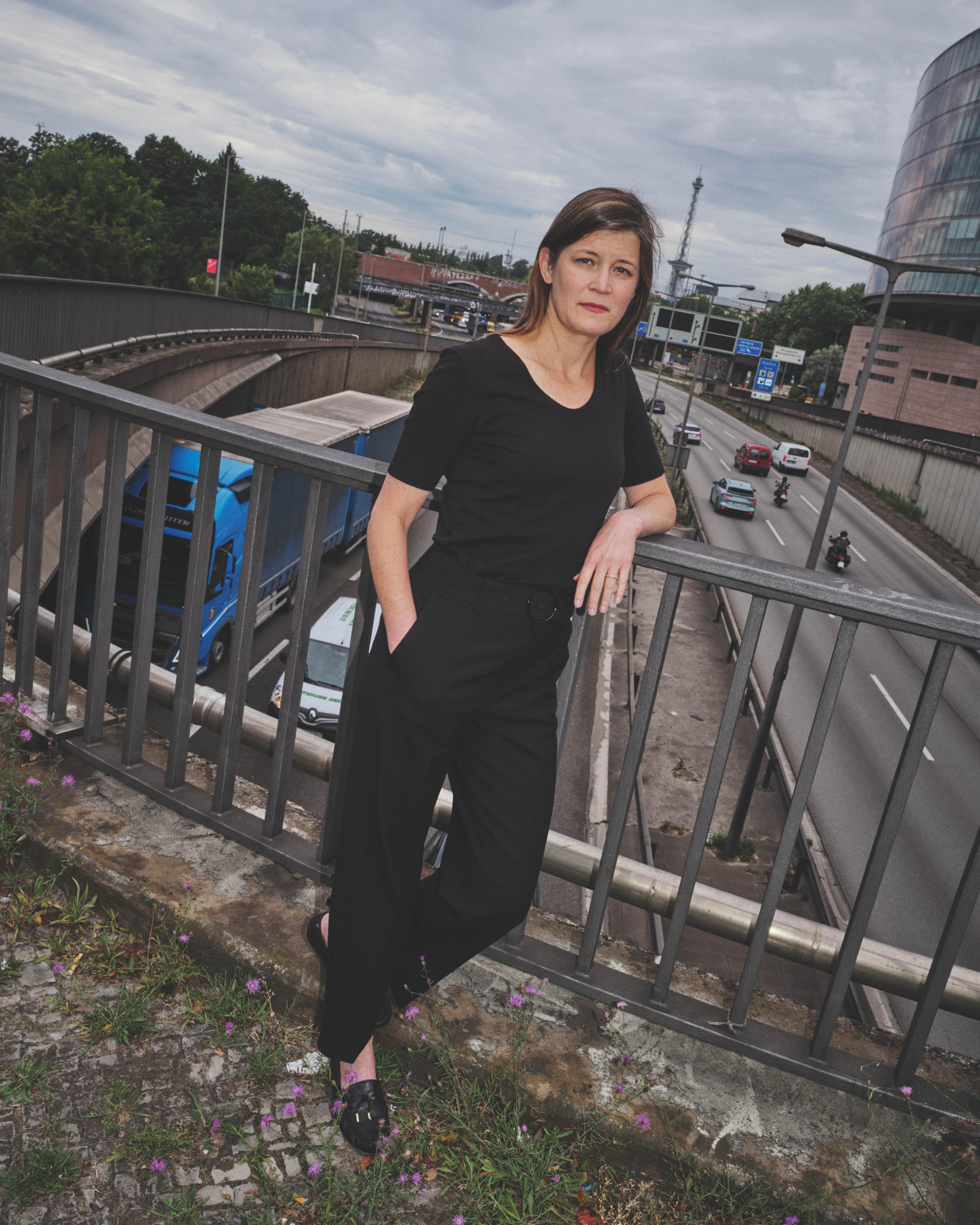Des pans entiers de la population occidentale sont en train de faire sécession : les très riches déguerpissent sur Mars et les gouvernements s’accaparent les dernières gouttes de pétrole, revendiquant le « droit à polluer ». Pour la chercheuse Cara New Daggett, l’exploitation des énergies fossiles alimente des masculinités problématiques depuis le XIXe siècle. Dézinguer la planète est un choix politique, pas une fatalité.
Puisque le concept de pétromasculinité peut être difficile à appréhender, commençons par la pratique du « rolling coal », rouler en voiture en produisant délibérément des fumées noires et épaisses. Est-ce une pratique représentative ?
Oui, bien qu’elle soit plus répandue aux États-Unis qu’ailleurs. La référence au charbon – coal – alors que ces moteurs diesel trafiqués n’en utilisent justement pas, est pour moi révélatrice de quelque chose de plus général : l’attachement aux énergies fossiles et à l’industrialisation, et la manière dont celles-ci sont constitutives de l’identité de certaines personnes, de leur vision d’elles-mêmes, de leur communauté et de leur histoire.
Qui sont ces hommes – et ces femmes – séduits par ces formes de masculinité ?
La pétromasculinité exerce un attrait sur les classes populaires blanches ayant souffert de la désindustrialisation de la « rust belt », ce croissant industriel au nord-est des États-Unis, mais aussi sur des communautés aisées installées en banlieue ou dans des gated communities. Elle ne s’exprime pas de la même manière dans les deux cas. Le « rolling coal » et les « convois de la liberté » en camions [un mouvement de protestation contre les restrictions sanitaires, né au Canada en 2022, qui inclut un volet pour la détaxation des carburants – Nda] ont beaucoup attiré l’attention médiatique, mais cela ne doit pas nous faire oublier les convois de yachts ou de SUV. L’anxiété et la colère réactionnaire qui s’expriment dans les pétromasculinités mettent en jeu la notion de privilèges, mais souvent moins en tant que réalité que comme sentiment que ceux-ci nous seraient dus. Contrairement à la façon dont elles sont parfois perçues, les recherches sur les masculinités ne sont pas des attaques contre les hommes. Elles appréhendent les masculinités comme des cultures charriant certains modes de vie, attitudes, styles, formes d’expression. Et celles-ci ne deviennent problématiques que lorsqu’elles sont prises dans des logiques de pouvoir – quand « être un homme » veut dire dominer les autres. En tant que cultures, les masculinités peuvent concerner des individus quels que soient leur genre, leur sexualité ou leurs origines. Sarah Palin [femme politique américaine membre du parti Républicain et égérie du mouvement du Tea Party – Nda] l’a parfaitement incarné en reprenant la célèbre phrase « Drill, baby, Drill » (« Fore, chéri, Fore »), un slogan en soutien à l’intensification des forages pétroliers). Alors qu’une petite majorité de femmes blanches a soutenu Trump lors de ses deux campagnes présidentielles, les femmes noires l’ont, elles, rejeté de façon retentissante. Ainsi, prendre en compte le racisme est essentiel pour comprendre comment les logiques de genre participent également du maintien des dominations.
Les pétromasculinistes affichent ouvertement fumées et pollution alors que nos sociétés cherchent à les camoufler. En ce sens, ne seraient-ils pas paradoxalement les pires ennemis du système qu’ils entendent défendre ?
C’est ce qui m’a le plus fascinée. Dans les systèmes capitalistes mondialisés, la pollution est cachée aux yeux des populations privilégiées. Tout est organisé pour que les externalités négatives soient reléguées dans des « zones sacrifiées » où vivent majoritairement des personnes pauvres et racisées qui ont à supporter ce fardeau de manière complètement disproportionnée. Prenons un exemple : l’Union Européenne a largement subventionné les granulés de bois comme alternative prétendument verte au charbon. Mais où sont coupées les forêts ? Où sont situées les usines toxiques ? Dans les communautés noires et indiennes du sud des États-Unis. Le greenwashing de l’Union Européenne se fait au détriment de ces populations et de ces écosystèmes. Les pétromasculinistes refusent l’hypocrisie de ce type de politiques environnementales solubles dans le capitalisme qui masquent la violence du système énergétique pour pouvoir continuer à en profiter. Plutôt que de lutter contre ces injustices, ils embrassent cette violence dans ce qu’ils vivent comme une lutte pour des ressources limitées : l’Occident doit vaincre pour assurer le progrès. L’un des slogans des Proud Boys, un groupe d’extrême droite américain, est : « Je suis un fier chauvin occidental et je ne m’excuserai pas d’avoir créé le monde moderne. » Ce réalisme violent est tout à fait compatible avec l’autoritarisme. Et dans un monde qui semble de plus en plus hors de contrôle, l’expression de cette violence permet à ces masculinistes d’exister comme acteurs, de calmer leur anxiété.
La pétromasculinité et ses pratiques sont souvent mises sur le compte de la bêtise. Vous montrez pourtant que le déni des bouleversements climatiques découle surtout d’un désir : celui que rien ne change.
Les scientifiques et les universitaires ont parfois tendance à expliquer l’inaction climatique par un déficit d’information : si les gens savaient plus, savaient mieux, s’ils faisaient l’expérience des conséquences dramatiques des bouleversements climatiques, alors ils comprendraient la gravité du problème. Et logiquement, ils chercheraient des réponses politiques constructives. Ajouter la question du désir à l’équation permet de comprendre que les résistances sont aussi culturelles. Les objets liés à la pétroculture, et plus largement à l’utilisation intensive de l’énergie, sont érotiquement chargés. Ce n’est pas seulement vrai pour les mouvements réactionnaires de droite : toute personne vivant dans une pétroculture – c’est-à-dire la majorité des habitants de la planète – est prise, d’une manière ou d’une autre, dans ces affects. Les réponses que nous devons inventer, collectivement, ne peuvent pas être uniquement technologiques. Elles doivent aussi prendre en compte ces enjeux culturels, d’identité, d’émotion et de désirs.
Comment définissez-vous les « pétrocultures » ?
L’avènement des énergies fossiles au XIXe siècle a rendu possible un mode de vie, un certain rapport au monde et a accompagné et nourri des idéaux – comme ceux de l’expansion et de la croissance sans limite – qui résonnent partout dans les cultures occidentales, et notamment dans les théories économiques. La massification de l’usage de ces énergies n’a pas créé une nouvelle civilisation – le capitalisme et l’impérialisme occidental lui précèdent – mais elle a permis une intensification de ces logiques et une manière de justifier le système au nom du progrès technique et de la scientificité. Aujourd’hui, la dépendance aux énergies fossiles des sociétés du Nord n’est pas seulement matérielle. Elle sous-tend aussi une certaine idée de la civilisation basée sur l’impérialisme, l’expansion et la propriété, ainsi qu’un certain nombre de valeurs : absence de limite, croissance des profits, accumulation. En ce sens, le défi écologique vient remettre radicalement en question les édifices historiques et philosophiques de l’Occident, comme son sentiment d’autosatisfaction. Et les solutions technocrates et capitalistes ne sont qu’une tentative de lutter contre le réchauffement climatique sans questionner l’enjeu de la domination occidentale.
La liberté fait-elle partie des valeurs prônées par les pétrocultures ?
Les notions américaines de liberté et de souveraineté sont profondément liées aux énergies fossiles. Peu de personnes le savent, mais au début du règne de l’automobile, il y a plus de 100 ans, les voitures à essence et les voitures électriques étaient déjà en compétition. Le choix de l’électrique – comme celui d’une organisation collective des transports – aurait vraiment été possible. L’une des raisons pour lesquelles les voitures individuelles à essence ont fini par dominer est liée à cette idée de liberté. Des historiens ont montré que le système électrique était perçu comme plus contraignant à mettre en place, car nécessitant des infrastructures de recharge et donc une planification politique centralisée. Par opposition, les voitures à essence promettaient l’aventure, la possibilité de prendre la route sans attaches, l’indépendance. Il y a là une ironie, évidemment, puisque ces dernières ont aussi besoin d’infrastructures, de stations-service et d’autoroutes. La liberté comme synonyme d’indépendance – vis-à-vis des autres, des infrastructures collectives et des écosystèmes – est un pilier de la culture américaine, même si elle est en parfaite contradiction avec l’un des enseignements de l’écologie : nous sommes tous interdépendants.
Les choix de ce type, comme les passages d’une énergie à une autre, ne sont-ils pas toujours des questions plus politiques et culturelles que technologiques ?
Les enjeux technologiques sont toujours, aussi, politiques et culturels. Andreas Malm a par exemple très bien montré que si le charbon et les machines à vapeur se sont imposés face à l’énergie hydraulique au XIXe siècle, ce n’était pas parce que ceux-ci étaient plus puissants et moins chers mais parce qu’ils permettaient d’accélérer l’urbanisation industrielle et de mieux contrôler les travailleurs. Le choix d’un système énergétique plutôt qu’un autre est une question politique qui soulève des enjeux de pouvoir et de distribution de ce pouvoir. La science et la technologie ne sont pas neutres. Ce sont des manières, parmi d’autres, de connaître le monde et d’interagir avec lui, déterminées par ceux qui posent les questions, ceux qui choisissent quels sont les problèmes requérant des solutions, ceux qui ont les moyens de financer la recherche, etc. Aujourd’hui, le développement technologique est ultra-privatisé. « Avec qui », « pour qui », « par qui » nous produisons de l’énergie sont des questions de démocratie qui passent systématiquement après les enjeux de profits. C’est la raison pour laquelle travailler sur les narrations énergétiques est en soi un enjeu politique. Le plus souvent, cette histoire est racontée d’un point de vue purement technique : une technologie supérieure est découverte, petit à petit adoptée, et apporte le progrès. Et cela nous incite à penser que, face aux dérèglements écosystémiques, nous n’avons qu’à attendre et espérer l’arrivée d’une nouvelle technologie plus efficace, moins chère et moins délétère pour le climat.
Dans ce cadre, peut-on envisager une réelle transition énergétique sans sortir du capitalisme ?
Le système capitaliste est incompatible avec la durabilité et la justice parce qu’il est toujours en quête du prochain profit, de la prochaine zone d’extraction, de la prochaine exploitation. Pour dépasser cette manie de la croissance propre au capitalisme, un premier pas pourrait être de repenser la notion de « bien-être » en revoyant la place que nous accordons dans nos sociétés à la santé, à l’éducation, au soin des enfants et des personnes âgées. Ces aspects-là ne doivent pas être considérés comme secondaires vis-à-vis de l’action climatique mais comme les outils d’une véritable politique écologique qui permettrait de sortir les sociétés du Nord global de la consommation de masse, et d’agir pour le bien-être des sociétés du Sud global – en termes de réparation, d’annulation de dettes, de souveraineté économique, etc. Prendre en charge, politiquement et collectivement, les sentiments d’anxiété actuels, relève de l’urgence parce qu’en attendant, l’extrême droite a très bien compris comment canaliser ces affects et les transformer dans les urnes. Et il ne s’agit pas là d’un programme seulement culturel, mais bien d’un projet matériel et concret qui implique des infrastructures, des ressources et de l’argent.
Les approches critiques féministes sont-elles armées pour prendre ces enjeux à bras-le-corps ?
Pour moi, le féminisme est une critique profonde du pouvoir et de son organisation, une tentative révolutionnaire au service de tous. Le système n’oppresse pas seulement les femmes, il est aussi soutenu par des logiques hétéronormatives, transphobes, racistes et coloniales. Il fait aussi du mal aux hommes blancs. Fondées sur la domination et l’impérialisme, les sociétés occidentales ont toujours impliqué beaucoup de violence. La question est de savoir comment celle-ci est répartie dans le monde. Ce constat n’a rien de nouveau pour ceux qui subissent depuis longtemps déjà la violence coloniale. Ceux-ci sont aussi rompus à l’idée de fin du monde : des mondes entiers ont déjà disparu à cause de l’impérialisme et du capitalisme fossile. Quand on ne les cantonne pas, comme souvent, aux questions de représentation des femmes ou aux violences qui leur sont faites, les pensées féministes sont une énorme source d’inspiration, notamment pour repenser le travail et les liens entre le mépris de la nature et celui des métiers culturellement attachés aux femmes. Sans basculer dans un rapport romantique aux professions du care – souvent très difficiles –, il est essentiel, si l’on souhaite mettre en place une vraie politique écologique, de les revaloriser et de mieux en répartir la charge.
• Pétromasculinité. Du mythe fossile patriarcal aux systèmes énergétiques féministes, éditions Wildproject, janvier 2023
Propos recueillis par Aïnhoa Jean-Calmettes
Photographie : Bastian Thiery, pour Mouvement
Lire aussi
-
Chargement...