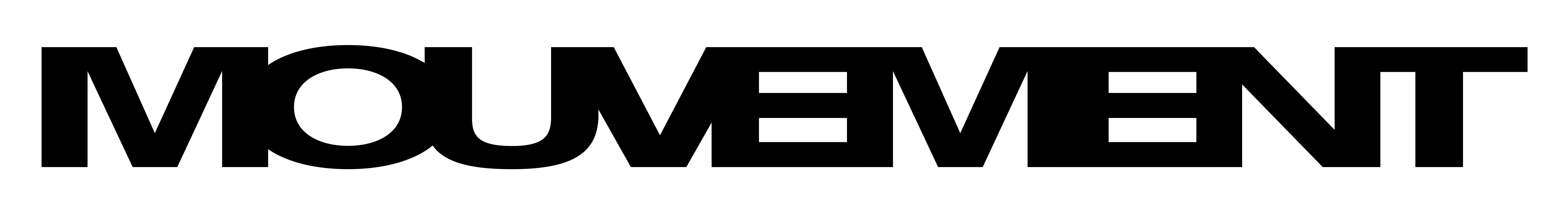Iels ont la petite vingtaine. Leurs poses sont lascives, leurs fringues criardes – top en plastique rose, résille trouée, combinaisons moulantes et pailletées. Et de la fumée synthétique s’échappe de leurs bouches comme s’iels allaient s’évaporer – ou qu’iels prenaient feu de l’intérieur. Les cinq protagonistes de Chemical Joy débordent d’une indifférence défiante, cette attitude apathique-chic devenue la signature d’une jeunesse à qui on ne la fait pas et qui veut le faire savoir. Pour sa nouvelle création, la chorégraphe Lenio Kaklea les a réuni·es dans un spectacle à deux vitesses. Collectivement, le casting exécute, l’air impassible et toujours à grand pas, une routine empruntée aux clips de pop. Puis, dans les solos ou duos, une autre histoire se joue : des moments de tâtonnement solitaire, comme face au miroir, ou de fabrication d’une sensualité à deux. Le spectacle s’ouvre sur un baiser lesbien extrabuccal – et ça ne sera pas le dernier.
Ces motifs ne seront pas étrangers au public des arts vivants et plus particulièrement de la danse contemporaine. En Espagne, l’égérie Candela Capitan a fait sienne cette imagerie teen-trash dans des performances glaçantes, tandis qu’en France le vidéo-théâtreux César Vayssié la déconstruit avec plus de distance, ou que le collectif la Horde en tire des méga-shows à la Disney. Lenio Kaklea jette pour sa part un regard froid mais empathique sur ces jeunes corps en quête de jouissance et d’une image d’elleux-mêmes. Un traitement qui passe par une série de contrastes, notamment dans les choix musicaux. Le glamour ou l’énergie déployés en plateau se voient fréquemment contredits par une bande-son industrielle sévère, parfois réduite à une simple rumeur métallique. Peut-être l’expression d’une intériorité moins festive que ce que donnent à voir les danseur·euses ?
Des poches d’obscurité plus explicites, Chemical joy en ouvre aussi, à deux reprises. C’est d’abord cette rechute après une séquence de numéros dansés. Tour à tour, façon télécrochet, les interprètes se donnent sur Hit me baby one more time de Britney Spears, classique inaugural qui, à 25 ans d’âge, a sa place dans le panthéon du vintage. Le plateau s’assombrit alors, et, presque en silence, les protagonistes errent sous les paroles du morceau projetées en fond de scène et détachées de leur sucre pop. Du mega tube ne subsiste plus que le drame juvénile de la solitude et de la dévotion amoureuse, en toute vulnérabilité.
Le spectacle se clôt sur une dernière zone d’ombre. La danse finie, la troupe se dénude et aménage un espace de jeu. Un caddie bourré de babioles est introduit, ainsi qu’une caméra retransmise en live – outil de prédilection pour signifier les pulsions scopiques de la jeunesse sur scène. À la lumière d’une torche, les voilà produisant le cinéma de leurs archétypes : la Lolita à sucette copulant avec son doudou, l’ado oisif éclatant des bulles de chewing-gums ou, plus flippant, un jeune homme en pleine strangulation. La dysphorie comme contre-champ de la performance de soi, encore et toujours. Et c’est dans cet aller-retour que le bien nommé Chemical joy prend du relief. Après avoir scruté les gestes du travail dans son Encyclopédie pratique (2019), Lenio Kaklea dresse ici une critique douce mais efficace des contradictions de la culture jeune, sans la vampiriser ni la couvrir de bons sentiments.
Chemical joy de Lenio Kaklea & le Bodhi Project, les 17 et 18 février dans le cadre du Festival Everybody au Carreau du Temple, Paris
Lire aussi
-
Chargement...