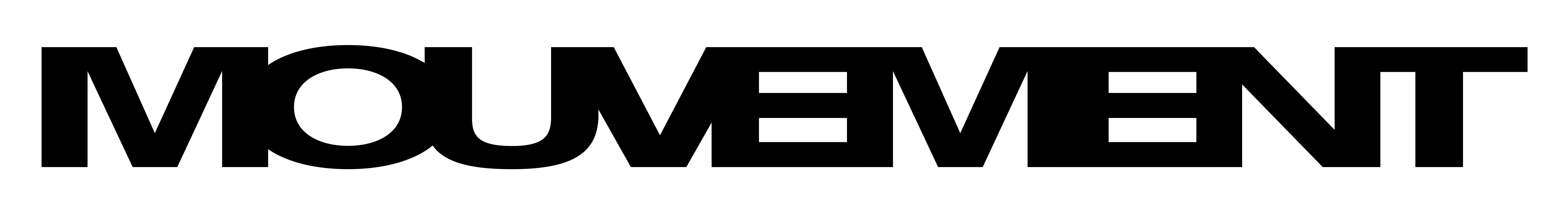Jeanne d’Arc fait régulièrement l’objet de films. Elle est devenue pour le Front national le symbole de la défense du pays contre l’envahisseur, tandis que des militants LGBTQI+ la célèbrent comme la première figure transgenre de l’histoire. Comment expliquez-vous son omniprésence dans l’imaginaire contemporain ?
Marion Siéfert : « Elle apparaît aussi dans des mangas, des films pornos… La quantité et la diversité des références à Jeanne d’Arc est vertigineuse ! Je pense surtout que son histoire est intimement liée à celle de la France : elle a réalisé l’unité du pays et en est devenue la « Patronne », religieuse et laïque. Lorsqu’on parle de Jeanne d’Arc ou que l’on s’agrippe à elle pour l’ériger en symbole, c’est toujours de la France dont il est question. Les différentes significations qu’elle revêt, pour le FN, le mouvement transgenre ou « La manif pour tous », cristallisent les conflits qui traversent le pays.
Helena de Laurens : « C’est une figure très ambivalente qui peut être mise au service de causes très différentes, en fonction des facettes que l’on met en avant : la figure guerrière ou celle, plus contemplative, de vierge pieuse ; son pouvoir ou la manière dont elle a été malmenée pendant son procès ; ce geste extrêmement fort de se vêtir « comme un homme » et de se couper les cheveux ; ou la façon dont sa parole est constamment mise en doute, ce à quoi on peut toujours s’identifier, aujourd’hui, quand on est une personne de genre féminin.
M. S. : « Le mythe d’une vierge qui sauverait la France existait déjà à l’époque. Il y a eu d’autres avatars de Jeanne d’Arc, avant celle que nous connaissons. Son histoire est aussi celle du contrôle du corps des femmes : elle va échapper au viol, subir des « examens médicaux » pendant son procès. Pour autant, on raconte aussi qu’elle aurait frappé ou tué des prostituées. Son corps est en tension constante avec le système patriarcal.
Interpréter Jeanne d’Arc était l’un de vos rêves, Helena. Marion vous a fait la promesse qu’elle vous confierait un jour ce rôle. Qu’est-ce qui vous intéresse, personnellement, dans cette figure ?
H. D. L. : « C’est moins la figure historique qui m’intéresse que la manière dont elle a été représentée au cinéma en fonction des époques et des réalisateurs, et ce que la fiction a fait d’elle. On ignore énormément de choses, ce qui laisse une place immense à l’imagination et fait d’elle un support de fantasme parfait. Je rêvais de me voir dans cette imagerie moyenâgeuse de la guerre, avec le costume, le cheval, la coupe de cheveux. Traverser cette histoire, qui est à la fois extrêmement épique et visuelle, et beaucoup plus abstraite quand il est question de sa foi, des voix qu’elle entend, de l’extase. Cette question du fantasme est motrice dans mon envie d’être actrice : dans quoi ai-je envie de me voir ? Comment ces fictions travaillent ce que je suis ? Au final, dans _jeanne_dark_, notre spectacle, je joue une ado de 16 ans mal dans ses baskets qui se raconte en live sur Instagram (rires).
M. S. : « Quand on travaillait sur Le grand sommeil, la première pièce qu’on a créée ensemble, Helena a sorti : « Je me couperai les cheveux uniquement quand je jouerai Jeanne d’Arc ! » Comme il y a toujours un aspect documentaire dans mon travail, je voulais partir de son imaginaire d’actrice. J’ai vite compris qu’elle n’avait pas forcément envie de verbaliser son fantasme et qu’elle ne se couperait pas non plus les cheveux (rires). En cherchant une autre matière pour la pièce, j’ai réalisé quelque chose que je n’avais pas du tout intégré : Jeanne d’Arc est très jeune, l’histoire se passe entre ses 16 et ses 18 ans. Je me suis alors penchée sur ce que je n’avais pas du tout regardé jusqu’à présent : qui j’étais, moi, à l’adolescence et quel rapport profond et personnel j’avais à la religion catholique.
En vous emparant de cette matière autobiographique, vous vouliez aussi « plonger dans un monde blanc ». Était-ce aussi une manière d’interroger les privilèges du milieu bourgeois dont vous êtes issue ?
M. S. : « Je voulais représenter ce qu’on ne représente pas, parce que ça nous paraît être l’évidence ou la norme. Lorsqu’on met en scène ce milieu blanc et bourgeois, on s’intéresse surtout aux affaires intimes, mais pas à sa structure, ni à son entre-soi ou à la position de pouvoir qu’il occupe. Comme l’expliquait la rappeuse Casey, quelque chose a changé sur la question du racisme ces dernières années : alors qu’on considérait que c’était aux personnes noires de la prendre en charge, on entrevoit désormais une volonté, chez les Blancs, de s’interroger sur leur rôle, de se déterminer et pas seulement d’écouter. La question du racisme ne se pense plus seulement depuis la marge, mais depuis le centre. Et comme il se trouve que je viens de ce monde blanc bourgeois, j’ai une forme « d’expertise ». Dire cash que nos grands-parents ont fait la guerre d’Algérie ou qu’on entend des propos racistes lors des dîners de famille peut permettre d’ouvrir un dialogue et de faire avancer les choses. J’avais aussi envie de parler du monde catholique, de son impensé en France. À part pour critiquer une poignée d’extrémistes, on ne parle jamais de cette religion. Les catholiques ne sont pas stigmatisés ou scrutés, il n’y a pas de Unes sur eux comme c’est le cas depuis 15 ans pour les musulmans.
Vous avez l’impression que la religion catholique est un tabou dans les milieux artistiques ?
H. D. L. : « J’ai reçu une éducation catholique moi aussi, plus soft que celle de Marion. Je n’ai jamais dû le cacher, mais je sentais bien, en tant que jeune artiste, qu’il fallait que je tourne un peu en dérision le fait d’être allée à la messe avec ma grand-mère. En France, on a tendance à rejeter la religion d’un seul bloc. Mais à mes yeux, « la religion » n’existe pas. De quoi parle-t-on ? Du clergé et de sa relation à l’État ? Des textes ? De la foi ? Des pratiques collectives ou intimes ? De l’imaginaire religieux ? De mystère ?
M. S. : « Ça va bien au-delà de la sphère artistique. Je me souviens qu’à l’école, je ne disais à personne que j’étais croyante pour éviter que les profs se foutent de ma gueule – les profs, pas les élèves. Je me sentais humiliée quand ils faisaient des blagues sur la religion catholique. Et encore, mes parents étaient très bien intégrés à la société. Je pense comprendre ce que peuvent ressentir des jeunes de confession musulmane aujourd’hui, qui s’en prennent plein la gueule, voient leur religion stigmatisée et leurs parents humiliés. Les articles sur la rencontre qui a été organisée sur le thème des religions entre la secrétaire d’État à la jeunesse et des jeunes à Poitiers en octobre dernier sont effrayants. Ces jeunes essayaient de dire qu’ils souffraient en voyant leurs amis attaqués dans leur foi : elle ne les a pas écoutés. Elle a répondu en martelant que l’école était un « sanctuaire de la République ». Aujourd’hui, en France, il n’y a aucun espace pour parler de la religion et la comprendre, alors que le vocabulaire catholique revient constamment dans la bouche de l’État. Dans la foulée, on apprend que la secrétaire d’État a requis une enquête sur la Fédération qui a organisé ladite rencontre…

La honte, le malaise ou les émotions négatives sont des matières d’écriture intéressantes pour le théâtre ?
M. S. : « La honte m’attire parce que ce sentiment produit des non-dits. On ne parle pas de ce qui nous embarrasse. C’est extrêmement puissant de casser la honte, d’exprimer ce que personne n’ose exprimer. C’est cette force-là qui me guide. Je ne trouve pas ça déprimant ou négatif, bien au contraire.
H. D. L. : « Après une représentation, des adolescentes m’ont demandé si j’avais fait une préparation pour avoir confiance en moi avant de jouer _jeanne_dark_. Ça m’a beaucoup étonnée, comme lorsque l’on me dit : « tu ne te mets vraiment pas en valeur » ou « tu ne t’embellis pas. » C’était comme si je faisais des choses très impudiques en déformant mon visage. Mais je suis extrêmement pudique ! Je peux être la plus hideuse possible, baver sur le téléphone, je ne suis pas en train de donner quelque chose d’intime. La pudeur n’est pas une question d’image. Évidemment, j’ai des doutes, mais pas sur ça. Modifier, déformer, reformer mon corps et mon visage, c’est justement ce qui m’intéresse. D’où ma passion pour la grimace et le corps grotesque, ce corps dont on ne sait pas très bien où sont les limites. Le commentaire le plus cool qui a été envoyé sur Instagram pendant un spectacle c’est quand même : « Tes narines sont les portes de l’enfer. »
Avez-vous toujours réussi à tenir la distance face aux commentaires parfois agressifs que vous recevez sur Instagram où la pièce est diffusée en direct ?
H. D. L. : « Parfois ça peut m’énerver. Mais je sais que les gens ne parlent pas de mon corps, plutôt d’une image, d’un angle de vue, du texte, du personnage, d’un certain moment de la pièce. C’est aussi ce qui m’excite le plus : jouer et voir les réactions que ça provoque ! Il y a des gens qui s’étonnent parfois de ces commentaires, comme si ceux qui les postaient oubliaient que c’est de la fiction. Je ne pense pas qu’ils considèrent mon personnage comme une « vraie » personne. Le contrat de fiction est clair. Mais ce n’est pas parce que c’est une fiction que ce n’est pas réel, que ces gens ne parlent pas réellement à quelqu’un. Dans Façons de lire, manières d’être, la chercheuse Marielle Macé parle très bien de ce rapport à la fiction, comment elle influence nos manières de vivre et notre rapport au monde.
M. S. : « C’est aussi un espace de jeu qu’on offre au public. Ça doit être excitant pour les spectateurs de se dire que s’ils commentent, Jeanne va peut-être leur répondre et les faire entrer dans la fiction. Ce rêve que soudain, les personnages sortent de l’écran de cinéma et t’embarquent avec eux. Je crois à la fiction au théâtre. Tous ces mots que les spectateurs envoient à Jeanne, c’est ce qui m’émeut le plus dans cette pièce… Inversement,
je crois que je vis beaucoup plus mal qu’Helena les commentaires de haters et de trolls. Avec eux surgissent toutes ces choses qu’on préférerait ne pas voir, gênantes, désagréables, inadmissibles parfois, mais qui existent et auxquelles on doit se confronter : c’est le monde dans lequel on vit. Les commentaires charrient toute l’idéologie de l’époque. Jeanne cristallise énormément de choses : c’est une fille, jeune, qui ose parler d’elle. Ce qu’elle se prend dans la gueule en retour est parfois extrêmement violent.
Marion, la question des réseaux sociaux est déjà présente dans votre première pièce 2 ou 3 choses que je sais de vous. Pourquoi cette matière vous intéresse ?
M. S. : « C’est d’abord une mine documentaire incroyable. Ces réseaux donnent accès à des bouts de vie, des informations plus informelles, des choses plus terre à terre ou les mondes intérieurs des gens. Leur folie aussi : les publications complètement compulsives, les manies, les obsessions. Et la manière dont chacun se transforme en marque ou en pub.
H. D. L. : « Tu auras beau parler d’autre chose que de toi – de politique, de livres – ce sera toujours de ta personne dont il sera question. Même sans selfie, on ne fait que se montrer.
M. S. : « C’est un espace de représentation, de fiction et d’invention de soi dans un cadre dicté, qui produit différents types de formes. C’est intéressant de le transposer au théâtre, qui est pour moi un espace de mise à distance et de critique. Les spectateurs qui voient _jeanne_dark_ depuis la salle de théâtre ont accès à la manière dont Helena se filme, comme une marionnettiste qui manipulerait ses objets à vue. C’est comme si Instagram était représenté, ce qui n’arrive quasiment jamais. On parle beaucoup des réseaux, mais moins de ce qu’on en fait dans la pièce : la manière dont on utilise la caméra, le grand angle, les gros plans. Personne ne fait des lives comme ça, d’aussi près ! Les gens posent leur téléphone, stable, avec un ring light, choisissent un bon fond et go ! Comme Instagram est un espace que les spectateurs connaissent, qu’ils investissent et utilisent habituellement, ils comprennent parfaitement ce que l’on est en train de faire techniquement. Résultat, ils se mettent à discuter de mise en scène dans les commentaires, de ce qu’ils auraient fait, de leurs idées. Et ça me plait énormément de partager ces questions avec eux.
Comment avez-vous pris la décision de jouer exclusivement sur Instagram les soirs confinés de spectacle ? Et pourquoi depuis une chambre et pas depuis la scène du théâtre, comme vous le faisiez les soirs « normaux » de représentation ?
H. D. L. : « C’est glauque de jouer face à une immensité de sièges vides. Si je joue dans un théâtre, c’est devant des spectateurs. Sinon je joue ailleurs.
M. S. : « Ne pas jouer aurait été presque snob ! Ça aurait été comme avouer que le public du théâtre était en réalité plus important pour nous que celui d’Instagram. Le compte _jeanne_dark_ avait trouvé son audience et on nous demandait régulièrement quand aurait lieu la prochaine performance. Jouer dans une chambre était l’occasion d’essayer autre chose. La pièce part d’une situation réaliste – une fille qui parle sur Instagram depuis sa chambre. Pourquoi ne pas nous confronter, pour une fois, à la réalité de cet espace-là, à ces quatre murs ? »
Propos recueillis par Agnès Dopff & Aïnhoa Jean-Calmettes
_jeanne_dark de Marion Séfert, du 20 au 22 mars aux SUBS, Lyon, dans le cadre du Festival Transforme 2025
⇢ du 2 au 5 avril au T2G, Théâtre de Gennevilliers
Daddy, les 11 et 12 mars à Bonlieu, Annecy
⇢ du 27 au 29 mars au Théâtre Vidy-Lausanne (Suisse)
⇢ du 22 au 25 mai à La Villette, Paris
Le Grand Sommeil, les 9 et 10 avril à Points Communs, Cergy-Pontoise
⇢ les 11 et 12 avril au T2G, Théâtre de Gennevilliers
Lire aussi
-
Chargement...