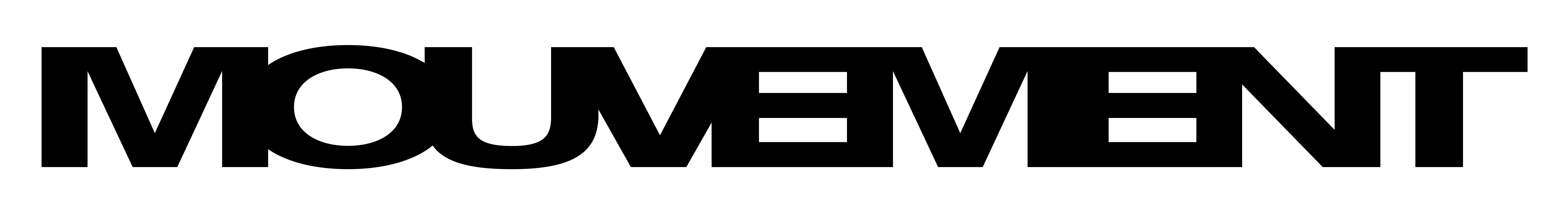De hautes cheminées s’élèvent comme une forteresse autour du Creusot, surnommé « la ville usine ». Ici, les industries s’insèrent jusque dans le centre de ce bourg façonné par Eugène Schneider qui régna en grand patron et père de famille sur la ville et ses ouvriers dans la seconde partie du XIXe siècle. Aujourd’hui, c’est le groupe ArcelorMittal qui fait et défait l’emploi depuis le Luxembourg. La branche sidérurgique du Creusot n’a pas encore délocalisé – les grands anneaux olympiques qui ont remaquillé la Tour Eiffel pour les Jeux Olympiques y ont été coulés. C’est aussi au Creusot qu’est inauguré le premier centre d’action culturelle en France devenu scène nationale en 1991. Au croisement entre la voie ferrée, la mairie et les entrepôts d’Industeel, l’arc est un point de jonction entre le culturel et l’industriel. Le cycle d’expositions « ManustenSions » qui s’y déroule jusqu’en juin creuse ces porosités dans un mouvement dialectique. « Que deviennent les mondes et les modes de travail ? » interroge la commissaire Élise Girardot. Quelles évolutions sous-tendent le remplacement du mot « ouvrier » par celui « d’opérateur », de « salarié » par celui de « partenaire » ? Le premier volet mettait en lumière les gestes manuels, leurs répétions et leur disparition, au sein des mondes industriels. Dans ce second volet, ces gestes deviennent révolte. Dans le troisième, consacré au geste performatif, il s’agira de déborder dans les rues de la ville ouvrière.
Liberté, je martèle ton nom
« Réparer la désobéissance », « bosser pour un salaire que t’as quasi pas », « un travail équitable ne tue pas » : dès l’entrée de l’exposition, on se confronte à un mur constellé d’écritures « sauvages », slogans de manif ou mot d’ordre de grève. Au sol, des inscriptions à la craie exigent le déchaînement ou le passage sous la guillotine de Thatcher – la tristement célèbre Première ministre britannique qui mata dans le sang la grève de plus de 130 000 mineurs en 1985. Entre ces appels à retourner symboliquement la violence du patronat, on réclame des bisous et des câlins. Des plaques de plexis rouge et des Ring Lights en suspens dans l’espace évoquent des spectres anonymes traversés par une énergie irradiante. Le titre de l’œuvre – Cœur liquide – tagué à la bombe rouge en tête du mur fait référence à la toute dernière technologie d’ArcelorMittal, et plus gros investissement d’Industeel, sa branche locale : la Coulée continue verticale, un procédé de solidification de métal en fusion qui permettrait « plus de performance, plus de qualité, de compétitivité et de décarbonation ». L’artiste Madeleine Aktypi y voit la métaphore d’une puissance révolutionnaire encore bien vive malgré l’étau qui l’enserre. Manière d’affirmer d’emblée, qu’ici, la vie ouvrière n’est pas une histoire ancienne : elle se déroule à la porte du théâtre, de l’autre côté de la rue. Elle s’écrit du sol au plafond, comme les prémices d’un débordement.
À l’envers du mur de contestation, l’installation de Brigitte Zieger continue d’écrire cette histoire à travers des gestes plus radicaux que le gouvernement qualifie de « casse », ou plutôt leur empreinte. On entre dans la maquette à taille humaine d’un coin de rue après le passage d’une manifestation : des fragments de façades surmontées de caméras de surveillance et décorées de slogans tels que « eat the rich », un distributeur de banque éclaté, des murs évidés. Le tout confectionné dans une résine uniformément grisâtre, donnant à l’œuvre des airs de vestiges. La rigidité des matériaux – référence à l’ordre établi dans l’espace public comme au sein de l’entreprise – est mise à mal par leurs formes molles, semblant fondre sous un feu invisible. Nos désirs font désordre (2022-2025) apparait comme une synthèse des derniers grands mouvements sociaux – des Gilets Jaunes aux révoltes urbaines suite au meurtre de Nahel Merzouk par la police. Autant d’actions en réponse à la violence d’État, criminalisées et cibles d’un mépris de classe – notamment de la part des institutions culturelles –, auxquelles il fallait bien rendre hommage sur la scène artistique.
 Vue de l’exposition ManutenSions.2 © Pauline Rosen-Cros / L’arc – scène nationale Le Creusot
Vue de l’exposition ManutenSions.2 © Pauline Rosen-Cros / L’arc – scène nationale Le CreusotL’internationale des invisibles
Le prolétariat contemporain et mondialisé a bien d’autres visages que celui, allégorique, de l’ouvrier. Le capitalisme, quant à lui, d’autres formes que celle du patron incarné. Le productivisme d’autres cadences que celles du fordisme. La série de photographies de Gilberto Güiza-Rojas – El Rebusque (2024-2025) – met en scène des « micro-travailleurs », sans contrat ni protection sociale, de Bogotá à Paris : vendeurs ambulants, porteurs, livreurs ubérisés. L’un d’entre eux, enveloppé dans une parka jaune fluo, serre son sac isotherme vert acide ; un autre est capté en suspension dans un survet’ bleu électrique sur son chariot rouge vif ; plus loin un Atlas ploie sous un régime de banane vertes et une livreuse tient son vélo par-dessus tête telle un haltère. Les tons saturés et les postures sportives brossent ces esclaves des temps modernes, soumis au rythme des alertes et des notes, en puissants athlètes. Signe, peut-être, qu’un « retournement des stigmates » peut aussi s’opérer sur le terrain du corps exploité et que l’Internationale des travailleur.ses n’a pas perdu de sa pertinence.
Dans la continuité, le film de Randa Maroufi déroule, dans un long travelling, les flux des hommes et des marchandises. Bab Sebta (2019) reconstitue à échelle 1 la zone frontalière de Ceuta, enclave espagnole au nord du Maroc. Un espace étroitement sécurisé où Guardia Civil, douaniers, touristes, travailleurs et contrebandiers se croisent. Filmés en plongée et en plan séquence, ces personnages – joués par les usagers de la frontière eux-mêmes et quelques acteurs locaux – suivent un parcours aussi labyrinthique que balisé. De l’attente, des contrôles, des files de voitures, des tas de sacs Lidl, des palettes et des fraudes. Ici, les gestes manutentionnaires – transvaser, emballer, porter – constituent des savoir-faire pour passer des marchandises en douce. Une équipe de femmes s’harnache méthodiquement des ballots sur le dos ou se scotche des sacs aux cuisses, dissimulés sous leur tchador. Les flux se matérialisent dans des successions de mouvements en tension : gardes et barrières finiront par céder sous la pression de la foule d’humains et de ballots. Ou comment le geste domestiqué devient le tremplin d’un retournement des rapports de force.
 Vue de l’exposition ManutenSions.2 © Pauline Rosen-Cros / L’arc – scène nationale Le Creusot
Vue de l’exposition ManutenSions.2 © Pauline Rosen-Cros / L’arc – scène nationale Le CreusotContre-saboter la roue de la fortune
Le capitalisme libéral est-il moralement plus légitime que les pratiques illégales ? Dans une salle aux allures de tripot sous la Prohibition consacrée aux œuvres d’Elsa Werth, trônent trois bidons reconvertis en tapis de jeu. Des paires de dés nous invitent au lancer. Sur les faces de l’un y sont gravés les mots « travailler », « consommer », « produire », « taxer », « payer », « gagner ». Sur celles de l’autre : « plus », « moins ». Voilà tout un modèle économique – et au-delà, nos existences – synthétisé en une poignée d’invectives. Au mur, des plis de suivis de courrier confidentiels entre patrons, comptables et administrateurs, réhaussés de cibles, se confondent avec le carnet de bord d’un tueur à gage. Le marché, sur lequel sont indexées les entreprises, et donc l’emploi, prend l’allure d’un système mafieux, brutal et hasardeux. Dans cette pièce statique – si aucun visiteur ne prend la peine de jeter les dés –, c’est une vidéo en fond de salle qui assure la cadence en générant via une intelligence artificielle des images d’objets futuristes pour compléter la phrase « If… Then… ». Un rébus obscur ou une loterie que plus aucune conscience humaine ne semble pouvoir enrayer, ni comprendre.
À mesure que nous traversons l’exposition, une tension dramatique monte en intensité. Sur le retour, un triptyque de Jean Gfeller – Hintertürchen (2024) – nous absorbe dans des couloirs aseptisés, à l’affût d’un éventuel « nervous breakdown ». Au détour d’une porte ou plantés en béquilles contre un mur, des personnages interchangeables en costume-cravate échangent des poignées de mains, passent un « call » ou se prennent la tête dans les mains. Chaque action, de la plus « banale » à la plus anxiogène, est traitée indifféremment. L’un d’eux soulève un tapis pour y découvrir un jeu de clefs. Un mystère glauque affleure à la surface des toiles, devenues le storyboard d’un thriller. Un écran sur trépied nous attend à la sortie de l’exposition. Avec sa vidéo Off Camera Dialogue (2014), Cally Spooner clôt le parcours sur une tonalité tragi-comique. Table blanche, mur gris. Un mug et une pile de papier. Plan resserré sur le buste d’un salary man, costume et cravate sombres, chemise blanche. On assiste à ce qui ressemble à un exercice de présentation de la boîte. Une voix générique, ferme, reprend une autre, plus fébrile, qui énonce des phrases toutes faites sur la croissance de l’entreprise. À l’écran, le mouvement des mains, machinique, tente de rythmer et d’appuyer ces éléments de langage vide de sens. L’être humain ne mime plus la machine mais le devient. Des chœurs s’élèvent, tournant en dérision le spectacle de la réussite. Les hésitations, les balbutiements, les redoublements : autant de grains de sable qui enrayent le dogme de la compétitivité, tout comme sur une chaîne de montage. Le sabotage, par voie orale ou manuelle, est à portée des cols bleus comme des cols blancs.
⇢ ManutenSions.2, exposition collective jusqu’au 15 juin à l’arc – scène nationale, Le Creusot
Lire aussi
-
Chargement...