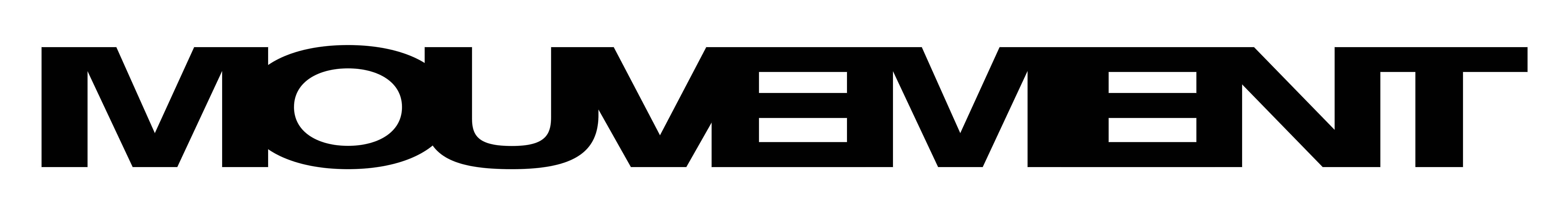Un entretien extrait du N°120 de Mouvement
Comment définir la petite bourgeoisie culturelle ? Vous utilisez aussi les expressions « petite bourgeoisie nouvelle » ou « aventuriers du quotidien ». Ces concepts se recouvrent-ils ?
Avec le développement de l’État social et les premières grandes politiques scolaires et culturelles des décennies d’après-guerre, le corps intermédiaire de la société se transforme. Toute une classe d’actifs se développe : les enseignants, les cadres de la fonction publique, les intermédiaires du travail artistique, etc. Si cette évolution est surtout quantitative, elle s’accompagne de pratiques et de modes de vie qui reprennent les codes de la contre-culture anglo-saxonne, notamment musicale, et qui vont peu à peu s’imposer : c’est ce que j’appelle la petite bourgeoisie culturelle. Le désaccord entre les sociologues Catherine Bidou, qui nomme ce groupe « aventuriers du quotidien », et Pierre Bourdieu, qui préfère parler de « petite bourgeoisie nouvelle », porte sur l’origine de ce style de vie. Pour Bidou, c’est l’invention d’un nouveau groupe social en dehors des rapports de classe existants. Par son positionnement politique et son style de vie, ce groupe fait un pas de côté par rapport à ce qu’on connaissait jusqu’alors : une culture bourgeoise d’un côté et une culture populaire de l’autre. Pour Bourdieu, ce groupe se prétend nouveau alors qu’il actualise de vieilles formes de domination. La culture de la petite bourgeoisie nouvelle n’est pas hors-sol : il s’agit bien d’une culture légitime, celle d’une certaine fraction de la bourgeoisie, qui est imitée.
L’avènement de cette bourgeoisie culturelle est intimement lié aux politiques menées par le Parti communiste puis le Parti socialiste. La culture serait-elle une affaire de gauche ?
La gauche a compris très tôt qu’il y avait des enjeux de pouvoir et de lutte derrière la définition de la culture légitime. Dès les années 1970, elle y voit un outil de politisation, quelque chose qui permet de faire du « soft power » comme on dirait aujourd’hui, notamment auprès des jeunes et des classes populaires. On peut remonter un peu plus loin : la petite bourgeoisie culturelle apparaît dans les années 1960 au sein des réseaux de partisans communistes liés à l’éducation populaire, avec cette idée forte qu’il faut réhabiliter les cultures populaires d’un côté, et diffuser la culture dominante vers le « bas ». Avec le déclin du Parti communiste – aussi bien électoralement qu’en termes d’ancrage dans les quartiers populaires – la compétence culturelle qui lui était confiée dans les conseils municipaux est progressivement reprise par le Parti socialiste. Pour autant, la culture a toujours été, aussi, un thème de droite et d’extrême-droite. Parce qu’en fond, c’est la question des frontières qui se pose : celle des frontières symboliques entre les groupes sociaux et celles entre les nationalités. Charles Maurras, dont la pensée ne cesse de rejaillir chez les intellectuels de droite et d’extrême-droite contemporains, considérait que la culture était liée aux racines profondes, à un territoire. C’est bien pour cela qu’il ne faut pas se mélanger : chacun à sa place. On peut également citer Alain Finkielkraut et sa critique virulente de la politique de démocratie culturelle menée par Jack Lang. Dès 1987 avec La Défaite de la pensée, il réfute l’idée que tout serait culturel et réaffirme les hiérarchies entre cultures savantes et cultures populaires. L’offensive réactionnaire contemporaine n’a rien de nouveau. Elle ne fait que réactiver des arguments anciens. En revanche, ces idées ont réussi à s’imposer.
De Malraux à Lang, la philosophie sous-jacente aux politiques culturelles évolue. Que se joue-t-il dans le passage de la « démocratisation culturelle » à la « démocratie culturelle » ?
L’objectif de Malraux est d’apporter la culture savante des élites aux classes populaires. Sa politique est à sens unique et descendante, dans la hiérarchie sociale et géographiquement. En bref, on construit des Maisons de la Culture pour faire circuler les oeuvres dans les territoires enclavés où le « bas peuple » n’a pas accès à l’Opéra. À travers son idéal de « démocratie culturelle », Jack Lang poursuit plutôt la réhabilitation des cultures populaires et/ou contestataires entamée par les communistes, et la pousse plus loin. Il peut se le permettre : le budget du ministère de la Culture, à cette époque-là, représente 1 % du PIB, ce qui ne risque pas d’arriver à nouveau. Suivant le principe que la culture existe dans tous les milieux sociaux, la politique à sens unique de Malraux est abandonnée. Le rôle des politiques culturelles est au contraire de mettre en valeur les cultures jugées les plus « fortes » et les plus « belles », ce qui concoure à en réhabiliter certaines dites minoritaires. Le cas du hiphop à la fin des années 1980, étudié par Marie Sonnette-Manouguian dans un ouvrage récent, Quarante ans de musiques hip-hop en France, en est un très bon exemple. Par ailleurs, la culture est pensée comme un outil d’émancipation sociale. À la fois parce qu’elle permet à des jeunes qui pratiquent des formes de cultures non légitimes de se professionnaliser, mais aussi parce que ces politiques les familiarisent avec une culture dominante qui leur permettra de grimper sur l’échelle sociale. À cette époque, faire circuler la culture est aussi important pour la gauche que de faire circuler les richesses.
L’idée que la culture serait un levier d’émancipation sociale, sur fond de lutte des classes – notion centrale pour le Parti communiste – ne s’est-t-elle pas perdue au profit d’une rhétorique de l’inclusion ?
La génération de petite bourgeoisie culturelle qui émerge dans les années 1980 est complètement empreinte de la théorie de la moyennisation d’Henri Mendras. Soit l’idée que tout se moyennise, et qu’il ne restera plus que quelques exclus que la gauche se chargera d’inclure. Avec l’effondrement de la pensée marxiste, le concept de lutte des classes perd de l’influence et n’est plus considéré comme un outil intellectuel pertinent pour penser le monde. Durant cette période, l’idée dominante c’est que les classes sociales vont disparaître. En 1983, quelques jeunes entre 19 et 25 ans présentent une liste aux municipales de Langres, afin d’obtenir un local pour organiser des concerts et des expos. Dans leurs tracts, contrairement à la génération communiste précédente, ils n’écrivent pas vouloir réduire les inégalités. Par contre, on y retrouve tout le vocabulaire de l’exclusion, appliqué cette fois à la jeunesse que l’on n’écoute jamais. En dépit de leur absence de culture politique et militante, ils font 3 % aux élections : tout de suite, ils apparaissent comme un relais crédible aux yeux du PS. Dans les années 1980, ceux qui ouvrent des salles de concert ou montent des festivals arrivent rapidement à se stabiliser professionnellement sur les registres de cultures qu’ils avaient auparavant défendus bénévolement, ou presque. En fonction du groupe dont ils sont issus, les trajectoires sont néanmoins différentes : les jeunes venant des milieux ouvriers vont plutôt faire du rock, de la radio libre et devenir journalistes ; ceux qui viennent des classes moyennes, plutôt s’investir dans l’art contemporain ou le cinéma – des formes de culture plus avant-gardistes – puis intégrer le conseil municipal ou d’autres positions politiques.
La petite bourgeoisie a la sensation que politiquement, elle continue de donner le ton car les quartiers d’habitat social votent encore à gauche, et que culturellement, l’empreinte de son style de vie est présente dans l’espace public.
Les années 1990 seraient-elles à la fois l’âge d’or et le début de la fin pour la petite bourgeoisie culturelle ?
La fin des années 1990 est un moment charnière. Les associations culturelles touchent des subventions records et embauchent le plus grand nombre de salariés. C’est aussi l’époque où la petite bourgeoisie culturelle détient le plus d’influence, même si un transfert de pouvoir est déjà en cours vers la bourgeoisie économique, ce qui ne fera que s’accentuer dans les années 2010, puis 2020. Comme le montre le sociologue Matthieu Hély, la professionnalisation des associations est paradoxale. En intégrant les politiques de la ville, celles-ci touchent certes plus d’argent public, mais cela les oblige à rendre des comptes. Pour reprendre la formule du spécialiste des politiques publiques Vincent Dubois, « concilier subventions et subversions » ne dure qu’un temps. Ce mouvement permet aussi à l’État de se désengager. Et en déléguant certaines de ses missions, il précarise l’emploi : les fonctionnaires sont remplacés par des travailleurs associatifs aux conditions de travail dégradées. Avec la Révision générale des politiques publiques de 2007, la tendance s’accentue : réduire les dépenses publiques et le nombre de fonctionnaires devient un objectif affiché. Les générations nées dans les années 1980 et 1990 n’auront pas les trajectoires de leurs aînés, la stabilité dont ces derniers ont pu bénéficier n’existant plus. Faire des sacrifices, s’investir énormément contre des rémunérations faibles ou inexistantes peut éventuellement tenir quand on est jeune. Mais sauf à venir d’un milieu privilégié, pas indéfiniment, en tout cas pas dans la durée. « Faire l’artiste » devient presque un luxe bourgeois ou petit bourgeois.
Doit-on chercher plus loin pour comprendre que les classes populaires se désintéressent de l’offre culturelle portée par l'État ?
L’alliance historique entre les classes populaires et la petite bourgeoisie culturelle – qui démarre dans les années 1970 avec le Programme commun, et se prolonge jusque dans les années 1990 – fonctionne parce que les deux groupes ont à y gagner. La petite bourgeoisie culturelle parvient à décrocher et à pérenniser des positions d’encadrement des classes populaires, que ce soit par l’éducation, le travail social ou le socioculturel, secteurs qui se développent fortement dans les années 1970-1980. De leur côté, les classes populaires profitent encore de l'ascenseur social. Seulement, celui-ci s'enraie, et les métiers d’encadrement se précarisent. Dans les années 2000, au sein du débat sur le déclassement, des sociologues comme Camille Peugny, Louis Chauvel ou Éric Maurin démontrent statistiquement une stagnation des chances d’ascension sociale, y compris dans les classes moyennes.
Au-delà de la fin de cette alliance historique, vous évoquez aussi la montée du mépris de classe dans la petite bourgeoisie culturelle. Effrayée de ne pas pouvoir maintenir sa position, se sent-elle soudain en compétition avec les classes populaires ?
Il existe une forme de concurrence objective et matérielle entre la petite bourgeoisie culturelle et les classes populaires, notamment dans l’occupation de l’espace public. Mais la petite bourgeoisie reste ambivalente vis-à-vis du populaire, comme le montrent les travaux d’Anaïs Collet sur la gentrification avec Rester bourgeois. Dans les endroits où la petite bourgeoisie se sent « gagnante », la mixité sociale est valorisée parce qu’encadrée. La petite bourgeoisie a la sensation que politiquement, elle continue de donner le ton car les quartiers d’habitat social votent encore à gauche, et que culturellement, l’empreinte de son style de vie est présente dans l’espace public. En revanche, dans les lieux où cette petite bourgeoisie se rend compte qu’elle a perdu sa capacité à donner le ton, l’altérité populaire n’est plus désirable. Le mépris de classe se débride alors, soutenu par l’idée que l’alliance de classe a d’abord été trahie par les classes populaires qui votent RN et qui n’ont plus aucune révérence pour la culture légitime que la petite bourgeoisie culturelle a à cœur de transmettre. Il s’agit d’un ressort de réassurance sociale. Fragilisée, la petite bourgeoisie culturelle se distingue en s’accrochant à ce qui lui reste : un style de vie qui n’est plus compris que par elle-même, ou quelques alliés. En tout cas de moins en moins partagé.
■ Le déclin de la petite bourgeoisie culturelle, Éditions Raisons d’agir, 2023
Lire aussi
-
Chargement...